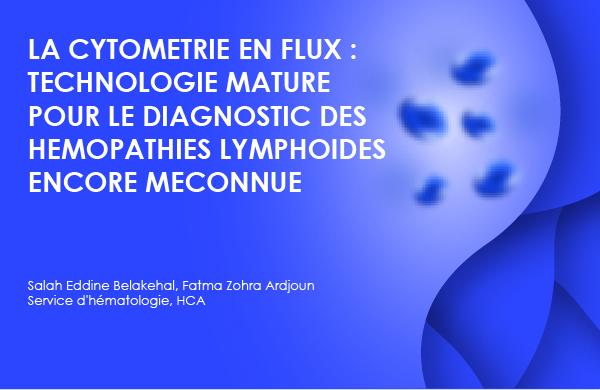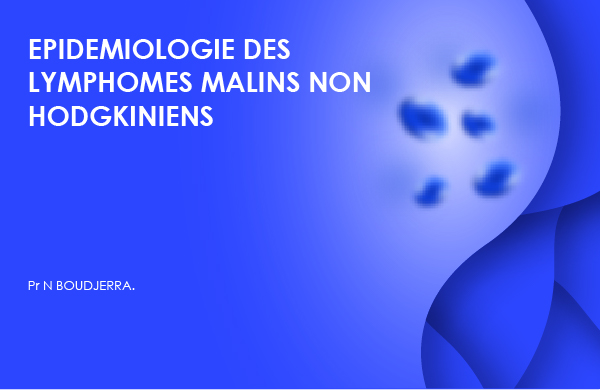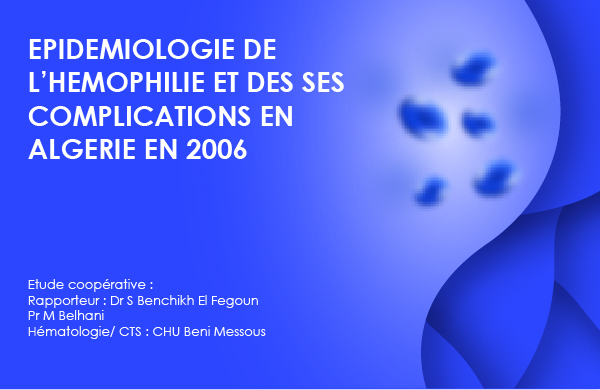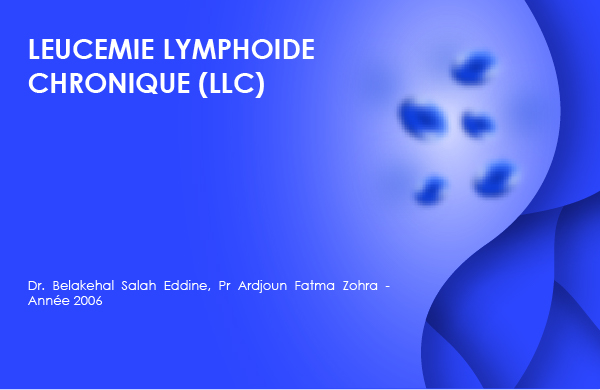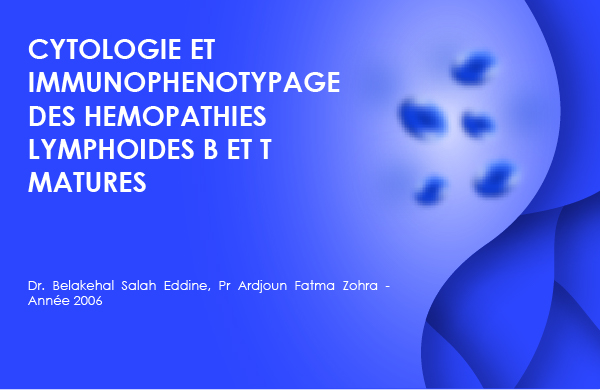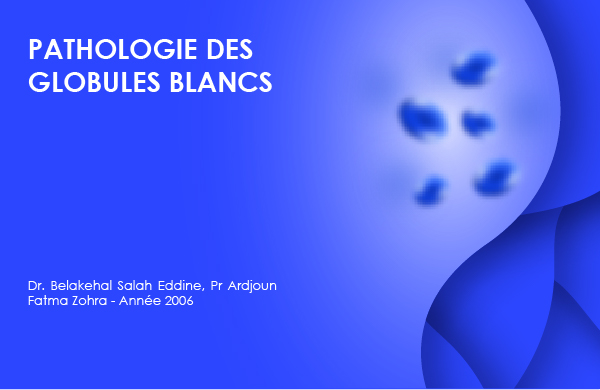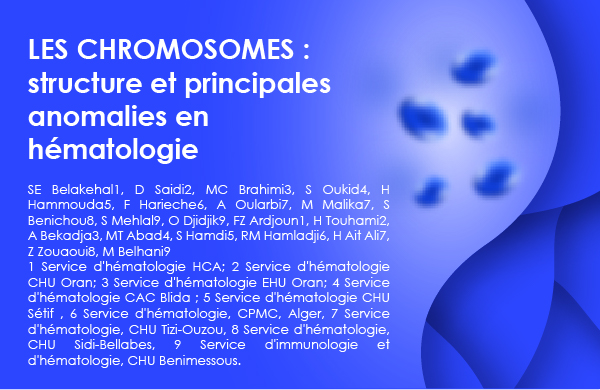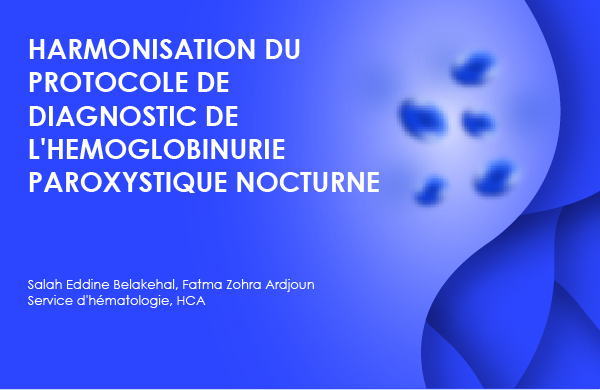Résumé :
Introduction : la cytométrie en
flux (CMF) se définie comme l'étude précise de cellules ou de particules
individualisées entraînées par un flux liquide. Il s'agit d'une technique de
caractérisation individuelle, quantitative et qualitative qui analyse les
signaux optiques ou physiques émis par ces cellules ou particules lors du
passage devant le faisceau lumineux d'un laser. Utilisée dès la fin des années
50, elle s'est beaucoup développée dans le secteur médical, notamment en
hématologie, en immunologie, en cancérologie mais également en pharmacologie.
Méthodes : En 2004, le service
d'hématologie a décidait l'acquisition de nouvelles technologies basées sur
l'imagerie cellulaire. En effet, la création d'un Plateau Technique de
Cytométrie en Flux complet a vu le jour en 2005.L'étude s'est faite de 2005 à
2008, en 2 étapes. Dans une première étape, nous avons mis en place la
technique. Dans une deuxième étape, nous avons d'abord travaillé avec des
prélèvements sanguins, puis avec des suspensions ganglionnaires.
Résultats : Après la mise en place du
plateau technique en Hôpital du jour et la formation des techniciens, nous
avons d'abord appliqué l'immunophénotypage sur sang (n=60 patients). Ensuite
nous avons appliqué cette technique aux ganglions, d'abord par ponctions aspirations
multiples (9 cas) puis par ponctions multiples sans aspiration (27 cas), et
enfin par trituration - dilacération (33 cas).
Conclusion : Ce document est une
référence pour les laboratoires pour la mise en place d'un plateau technique de
cytométrie en flux et son application aux prélèvements sanguins et
ganglionnaires.
Mots clés : Cytométrie
en flux, Plateau technique, Immunophénotypage, lymphomes
INTRODUCTION
L'essor de la CMF s'est consolidé avec le développement
des anticorps monoclonaux, de sondes fluorescentes mais également grâce aux
progrès technologiques réalisés en électronique, en informatique et dans la
conception des lasers. La CMF est donc en constante évolution. Aujourd'hui,
c'est une technique de routine en hématologie, notamment dans le diagnostic des
leucémies aigues, les lymphomes et hémoglobinurie paroxystique nocturne. C'est
dire l'importance de la CMF.
D'ailleurs, c'est suite à des problèmes diagnostiques, et compte tenu des
difficultés locales d'application de l'immunohistochimie, que nous avons décidé
de mettre en place cette technique en 2004. On notera qu'en 1992, le nombre de
cytomètres utilisés dans le monde était estimé à 7000 (1), alors qu'en 1998,
leur nombre était estimé à 2 en Algérie, 1 au CPMC, et 1 au CTSA- Alger. C'est
en 1999 que la première étude par cytométrie en flux, dans la classification
des leucémies aiguës, est réalisée en Algérie (2).
MATERIEL ET
METHODES
MATERIEL
1. POPULATION D'ETUDE :
C'est une étude prospective qui a concerné 129 patients recrutés durant la
période allant de janvier 2006 à décembre 2008.
2. LA MISE EN PLACE DE LA TECHNIQUE DE CYTOMETRIE EN FLUX
:
La mise en place de la technique de cytométrie en flux (CMF) s'est faite
progressivement depuis l'année 2004, et la création d'un Plateau Technique de
Cytométrie en Flux complet a vu le jour en 2005 (3).
Le matériel nécessaire pour le fonctionnement d'un laboratoire de CMF comporte
un équipement spécifique et non spécifique et du matériel consommable.
2.1. Equipement spécifique :
Nous avons utilisé un cytomètre en flux multicouleur type, FACSCalibur Becton-
Dickinson (BD), avec un seul laser type Argon (fig1) et un automate de FNS.
Figure 1 : Un cytomètre en flux type,
FACSCalibur
2.2. Equipement non spécifique (fig2):
- Centrifugeuse réfrigérée de paillasse ; Microscope optique avec appareil
photographique ;
- Réfrigérateur ; Agitateur rotatoire type Vortex ; Appareil pour coloration de
lames.
2.3. Matériel consommable :
- Tubes Falcon de 5 ml [adaptables au cytomètre] ; Pipettes ; Embouts jaunes et
bleus ; Filtres à 50 μm de porosité ;
Seringues ; Bistouris ; Lames ;
- Trocarts de ponction biopsie osseuse ; Pinces à disséquer ;
- Chronomètre ; Portoirs ; Cellules de Malassez et lamelles.
Figure 2 : Matériel consommable pour
plateau technique de CMF (3)
2.4. Réactifs :
2.4.1. Les anticorps monoclonaux sont couplés à un fluorochrome,
soit FITC, soit PE, soit PerCP. Les AcM utilisés sont commercialisés par la
firme Becton-Dickinson et sont les suivants :
- Marqueurs B : CD19, CD20, CD22, CD79b, FMC7, chaînes lourdes mu, chaînes
légères Kappa et Lambda
- Marqueurs T : CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8, TCRα/β, TCRγ/δ, CD1a
- Marqueurs NK : CD56, CD57, CD16
- Marqueur du centre germinatif : CD10
- Marqueurs d'activation : CD25, CD38, CD24, CD23, HLA-DR, CD103, CD11c
- Marqueur pan-leucocytaire : CD45
- Un couple d'AcM a été également utilisé de façon systématique, ce sont des
immunoglobulines incomplètes (chaînes lourdes γ1 et γ2 sans fragment Fab) : ces spécificités servent de témoin
négatif en occupant toutes les liaisons non spécifiques.
2.4.2. Les
billes de calibration : sont des billes en polyméthylmétacrylate d'environ 6
microns qui simulent des cellules sanguines normales. Trois sortes de billes
sont utilisées :
- billes blanches qui simulent les cellules non marquées.
- billes couplées à la FITC.
- billes couplées à la PE.
- billes couplées à la PerCP
Ces billes de calibration nous ont servi à effectuer les réglages de la tension
des tubes photomultiplicateurs (PMT), à ajuster la compensation de
fluorescence, et à vérifier la sensibilité de l'appareil.
2.5. Solutions :
- Solution de lyse des globules rouges, 10 fois concentrée, conservée à
température ambiante après reconstitution ; Solution tampon PBS ou « cell-wash
» ; Isoton ou liquide de gaine : « Facs-flow » ;
- Solutions d'entretien des tubulures de l'appareil : « Facs-rinse » et «
Facs-clean » ; Eau physiologique à 9‰.
2.6. Personnel
Le fonctionnement du laboratoire de CMF a nécessité un minimum de 3 personnes :
1 hématologistes et 2 techniciens supérieurs en biologie.
METHODES
1) Données clinico-biologiques
Nous avons établi, une fiche de renseignements pour chaque patient recruté, qui
comprend les informations suivantes : nom, prénom, âge, sexe, service, examen
clinique, et examens para cliniques.
2) Prélèvements
a) Un prélèvement sanguin de 5 ml sur EDTA est systématiquement demandé et
permet de faire :
- Une numération formule sanguine.
- Un frottis sanguin coloré au May Grunwald Giemsa (MGG).
- L'immunophénotypage par CMF, si le taux de lymphocytes est ≥ 4000 / mm3.
- L'acheminement du prélèvement est fait dans les 24 h, et dans tous les cas,
la conservation du prélèvement est faite dans le tube d'origine, et sans
modification, à température ambiante (20-25°C).
b) Prélèvements ganglionnaires :
- Ponctions multiples : Les ponctions multiples (2 à 3) à l'aiguille fine, de
21 G de 0,8 x 40 mm de diamètre (fig3) , montée sur une seringue de 10 à 20 cc,
préalablement rincées à l'EDTA.
Figure 3 : Ponction ganglionnaire, sans aspiration et avec aspiration avec une
aiguille fine, de 21 G de 0,8 x 40 mm de diamètre (3)
- Perfusion et / ou trituration dilacération :
- Après biopsie ganglionnaire en chirurgie, l'acheminement a été fait dans
l'heure qui a suivi le prélèvement dans une compresse imbibée de sérum
physiologique. Le fragment est perfusé avec 3 à 4 ml de sérum physiologique
puis on effectue une trituration-dilacération afin d'obtenir une suspension
cellulaire.
- La suspension est reprise dans un tube contenant de l'EDTA ou un tube Falcon,
après filtration (filtre à porosité 50 μm), puis on procède à une numération automatique ou
manuelle des cellules.
3) Application de la technique sur sang ou ganglion :
a) Prélavage pour le marquage des immunoglobulines de surface (IgS) :
- Prélavage : Le but de ce prélavage est d'éliminer les IgS circulantes qui
empêchent la fixation des anticorps fluorescents sur les cellules par
compétition.
- On prend 200 μl de sang total
dans un tube Falcon ; On procède au 1er lavage avec 3 ml de PBS (cell-wash).
- On mélange au vortex, puis on centrifuge pendant 5 min à 300 g.
- Le surnageant obtenu est éliminé par aspiration en utilisant une pipette à 50
μl. On rajoute 3
ml de PBS et on procède à un 2ème lavage.
- Marquage des IgS :
- Dans tube Falcon, on met 10 μl d'anticorps de spécificité connue (peuvent être
distribués avant ou après l'échantillon) avec 100 μl de sang lavé :
|
Acs1-FITC |
Acs2-PE |
Acs3-PerCP
sang lavé |
- Après incubation, on rajoute 2 ml de solution de lyse
diluée au 1/10ème dans de l'eau distillée. On effectue 2 lavages avec 3 ml de
PBS.
- On remet en suspension le culot cellulaire, avec 0,5 ml de cell-wash, et puis
on procède à la lecture au cytomètre.
b) Marquage cellulaire sur sang en immunofluorescence directe :
Un double marquage a été utilisé dans la majorité des cas. L'Acs1 est couplé à
un
fluorochrome (exemple FITC) et l'Acs2 est couplé à un second fluorochrome
(exemple PE).
Nous avons effectué en un seul temps dans la majorité des cas, le marquage dans
un tube de 2
Acs conjugués
ANALYSE DE LA
CASUISTIQUE
1. REPARTITION SELON L'AGE ET LE SEXE
Figure 4 : Répartition selon l'âge et le sexe
2. RESULTATS DE
L'IMMUNOPHENOTYPAGE SUR PRELEVEMENT SANGUIN (3)
- Sur 60 lymphocytoses sanguines, nous avons évoqué sur
l'aspect cytologique du frottis sanguin, le diagnostic de LLC dans 59 cas et le
diagnostic de leucémie aigue dans 1cas;
- Nous avons retenu après immunophénotypage par CMF:
- 52 LLC, dont 10 LLC mixtes,
- 4 lymphomes de la zone marginale, 1 lymphome folliculaire, 1 lymphome à
cellules du manteau,
- 2 leucémies à grands lymphocytes à grains-T.
- Le score de Matutes a été utilisé dans les 60 cas, pour distinguer les LLC
typiques et atypiques des autres lymphomes en conversion leucémique.
- Le diagnostic est posé, en prenant compte des données morphologiques et
immunophénotypiques.
- Le myélogramme, geste invasif et douloureux pour les patients n'a pas été
indispensable au diagnostic de LLC, car il a été avantageusement remplacé dans
les 52 cas, par l'étude du phénotype des lymphocytes dans le sang périphérique
par CMF.
- Les 42 cas de LLC typiques montrent un monomorphisme cellulaire avec
lymphocytes matures, moins de 5% de prolymphocytes et la présence d'ombres de
Gumprecht dans tous les cas. Les 10 LLC mixtes montrent un taux de
prolymphocytes entre 10% et 55%. 39 LLC (75%) avaient un score de Matutes
supérieur ou égal à 4.
- En ce qui concernant les lymphomes en conversion leucémique, nos résultats
montrent la difficulté de poser le diagnostic sur le simple aspect
morphologique. Parmi les 60 cas avec lymphocytose sanguine, nous avons retrouvé
8 cas, soit 13,33% avec un score de Matutes < à 3.
3. RESULTATS DE L'IMMUNOPHENOTYPAGE SUR PRELEVEMENT
GANGLIONNAIRE (3)
Dans notre étude nous avons diagnostiqué :
- 23 LNH-B,
- 1 LNH-T,
- 7 adénites réactionnelles,
- 3 maladies de Hodgkin
- 2 métastases d'un carcinome.
Dans notre série de 24 LNH primaires, on retrouve une restriction kappa dans 9
cas, et une restriction lambda 4 cas. Dans 4 cas, on ne retrouve aucune
restriction aux chaînes légères, sur une population B majoritaire (CD20 >
85%). La coexistence de cellules lymphoïdes bénignes et malignes, peut
expliquer l'expression des 2 chaînes légères. Dans 6 cas, les Ig de surface
n'ont malheureusement pas étaient testées en raison d'une insuffisance
cellulaire.
Le diagnostic de LNH-T a été porté dans 1 cas sur l'expression majoritaire de
cellules T (CD3
> 90%).
DISCUSSION
Dans la démarche de mise en place de la technique de cytométrie en flux, nous
avons d'abord travaillé avec des prélèvements sanguins, puis avec des
suspensions ganglionnaires, obtenues soit par ponctions multiples, soit par
perfusion / trituration dilacération.
Dans notre série de 60 patients, la lymphocytose sanguine est supérieure à 4000
/mm3. Les critères diagnostic sont identiques à l'étude de Bezzari (4) et
Struski (5).
Nous avons retrouvé : 52 LLC, dont 42 typiques (81%) et 10 mixtes (19%). Les 42
cas de LLC typiques montrent un monomorphisme cellulaire avec lymphocytes
matures, moins de 5% de prolymphocytes et la présence d'ombres de Gumprecht
dans tous les cas. Les 10 LLC mixtes montrent un taux de prolymphocytes entre
10% et 55%, conformément aux données de la littérature.
Tableau 1 : Résultas de
l'immunophénotypage sur sang, et score de Matutes
Selon Felman (6), l'analyse cytologique du frottis
sanguin ainsi que l'immunophénotypage de la population cellulaire pathologique
constitue les outils diagnostiques indispensables à l'identification des
lymphomes à dissémination sanguine.
Tableau 2: Données de la littérature
sur la validation de la CMF sur suspensions cellulaires
Tableau 3 : Résultas de
l'immunophénotypage sur ganglion
Tableau 4 : Résultas de
l'immunophénotypage sur ganglion
La majorité des auteurs (7, 8, 9), recommandent
l'utilisation de la cytométrie en flux, appliquée aux ponctions ganglionnaires
; car il s'agit d'une technique rapide, répétitive, non traumatique, et ne
nécessitant pas une hospitalisation. Le clinicien est orienté dans la journée ;
et cela permet un gain de temps inestimable, pour le patient et le médecin
traitant (3).
Certains auteurs (10), estiment que le diagnostic de LNH peut être retenu, sur
la base de données cliniques, cytologiques et immunophénotypiques. L'étude
histologique n'est indiquée que dans les cas où la monoclonalité n'a pas été
démontrée (11, 12). Dans notre étude, tous les patients ont été traités après
confrontation des données cytologiques, immunophénotypiques, et
anatomopathologiques.
Tableau 5 : Les avantages et les
inconvénients de la CMF sur suspension ganglionnaires par ponction
ganglionnaire et par perfusion et ou trituration dilacération (3)
CONCLUSION
Cette étude s'était fixée pour objectifs :
- d'organiser et de mettre en place le Plateau Technique de Cytométrie en Flux.
- d'appliquer la cytométrie en flux sur sang puis sur produit ganglionnaire
soit par ponctions multiple et / ou par perfusion et / ou trituration sur
ganglion biopsié.
Pour réaliser ces objectifs, nous avons choisi une étude
prospective portant sur une population de 129 patients.
L'étude s'est déroulée en deux temps :
- Dans une première étape, nous avons mis en place le Plateau Technique de CMF.
Cette période nous a permis de mieux nous familiariser avec la technique de CMF
sur sang. Nous avons appris à repérer les populations cibles, à choisir les
différents panels en fonction de l'aspect morphologique du frottis sanguin, à
faire les contrôles de qualité interne de l'instrumentation, et à analyser les
résultats immunophénotypiques.
Pendant cette période également, nous avons formé sur place 2 techniciennes en
biologie pour la manipulation des anticorps monoclonaux et des échantillons.
- Dans une deuxième étape, nous avons appliqué cette technique aux ganglions,
d'abord par ponctions aspirations multiples (9 cas) puis par ponctions
multiples sans aspiration (27 cas), et enfin par trituration - dilacération (33
cas).
Ainsi, il apparaît dans tous les cas, que loin de s'opposer, la technique
d'immunophénotypage par CMF complète utilement la cytologie et / ou
l'anatomopathologie dans le diagnostic et la classification des LNH.
Au total, ce travail apporte une contribution à la connaissance d'une technique
diagnostique performante, utile dans les lymphomes malins non hodgkiniens, et
peu répandue en Algérie.
BIBLIOGRAPHIE
[1]. MANDY FF, BERGERON M, MINKUS T, et al. Principles
of flow cytometry. Transfus. Sci.
(1995) Vol.16, No.4, pp. 303-314.
[2]. TRABZI – AZELI A, et al. Application de l'immunophénotypage à la
classification des leucémies aigues. Thèse pour DESM- Alger, (1999)
[3]. BELAKEHAL SE, ARDJOUN FZ. Apport de la cytométrie en flux dans le
diagnostic et la classification des lymphomes. Thèse pour DESM- Alger, (2009)
[4]. BEZZARI M, et al. Hémopathie lymphoïde chronique B; Diagnostic cytologique
et immunophénotypage sanguin. Laboratoire Casablanca Maroc (2005),
http//www.santé.gov.ma/departement/INH
[5]. STRUSKI S, LEYMARIE V, HELIAS C, et al. A cytological,
immunophenotypical and cytogenetical study of 136 consecutive cases of B-cell
chronic lymphoid hemopathies. J. Path. Bio. (2006)
[6]. FELMAN P, MERLE-BERAL H, et al. Présentation
Hématologique des Lymphomes à cellules B matures (ganglionnaires et extra
ganglionnaires). Rev. Fran. Lab.(2006), N°379
[7]. ZARDAWI IM, JAIN S, BENNETT G, et al. Flow-Cytometric Algorithm on
Fine-Needle Aspirates for the Clinical Workup of Patients With Lymphadenopathy.
Diagnostic Cytopathology, (1998), 19, No 4
[8]. DUNPHY CH, et al. Contribution of Flow Cytometric Immunophenotyping to the
Evaluation of Tissues With Suspected Lymphoma? Cytometry (2000), 42 :296–306
[9] EL-SAYED AM, EL-BORAI MH, BAHNASSY AA, et al. Flow cytometric
immunophenotyping (FCI) of lymphoma: correlation with histopathology and
immunohistochemistry. Diagnostic Pathology (2008), 3:43
[10]. MEDA BA, BUSS DH, WOODRUFF RD, et al. Diagnosis and subclassification of
primary and recurrent lymphoma. The usefulness and limitations of combined fine-needle
aspiration cytomorphology and flow cytometry. Am J Clin Pathol. (2000),
113:688–699
[11]. ZEPPA P, MARINO G, TRONCONE G, et al. Fine-Needle Cytology and Flow
Cytometry Immunophenotyping and Subclassification of Non- Hodgkin Lymphoma, A
Critical Review of 307 Cases with Technical Suggestions. Cancer Cytopathol.
(2004), 102 :55–65
[12]. DEY P, AMIR T, AL JASSAR A, et al. Combined applications of fine needle
aspiration cytology and Flow cytometric immunphenotyping for diagnosis and
classification of non Hodgkin Lymphoma. CytoJournal
(2006), 3:24
REMERCIEMENTS, pour leur contribution scientifique :
- Les services d'hématologie du Pr RM Hamladji, du Pr MT Abad, et du Pr H Ait
Ali.
- Le CTSA, Kouba du Col M Ardjoun.