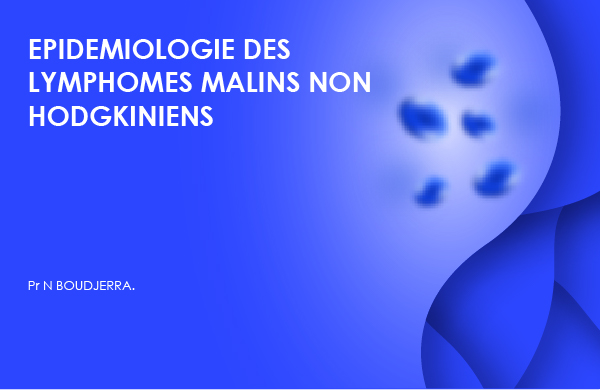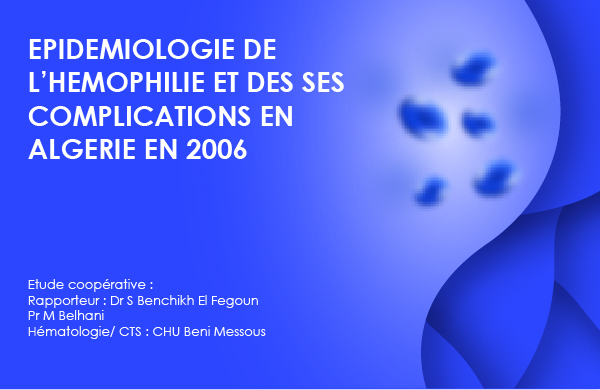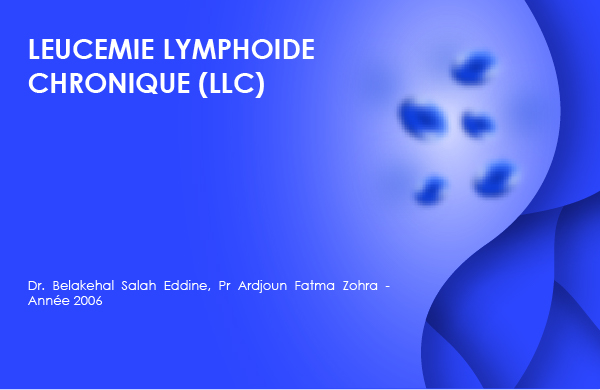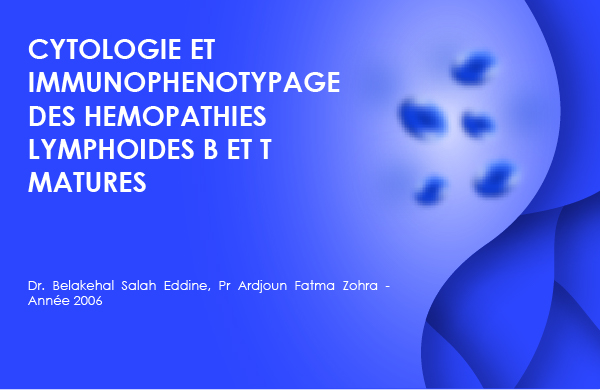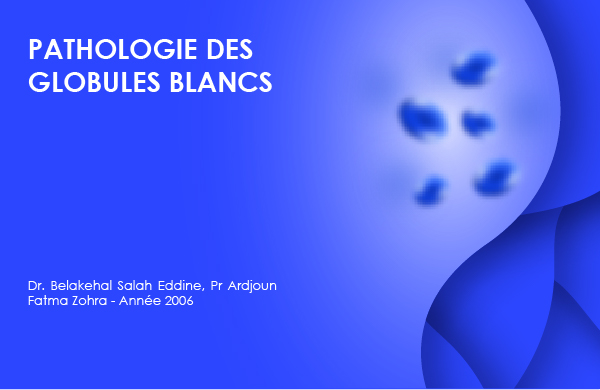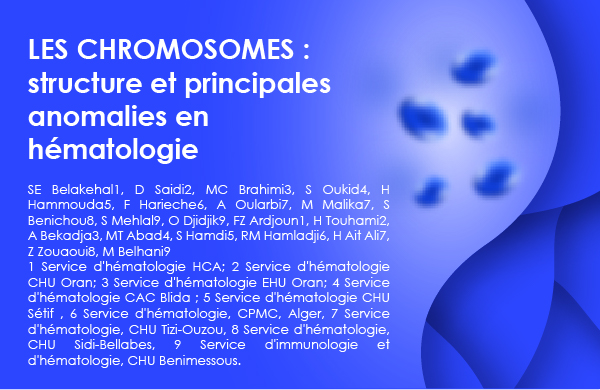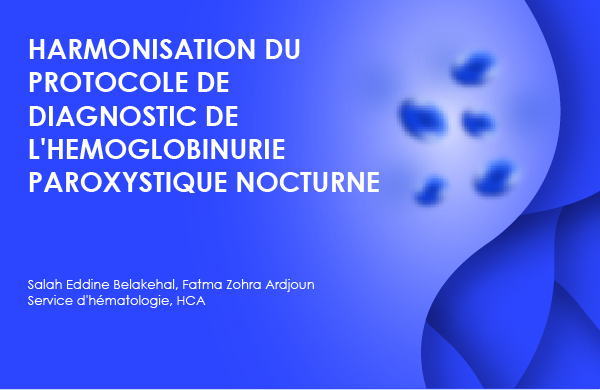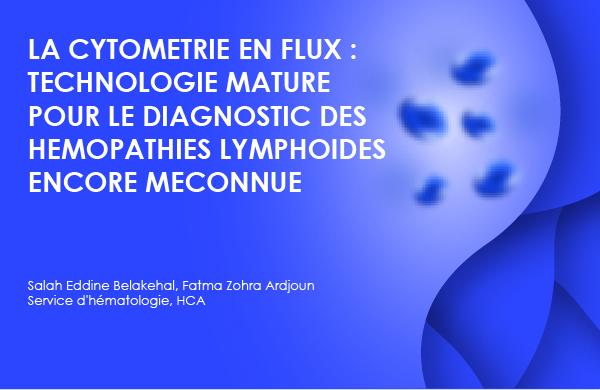Résumé :
Le myélogramme ou
ponction de moelle consiste à prélever par aspiration à la seringue quelques
grains de moelle osseuse. Son but est d'étudier morphologiquement et
numériquement les éléments du tissu hématopoïétique de façon qualitative et
quantitative.
Le respect de quelques recommandations
simples, permettra l'amélioration de sa pratique.
Mots Clés : Myélogramme,
Ponction aspiration de moelle, Etude cytologique
INTRODUCTION
L'examen de la moelle osseuse est un outil diagnostique précieux pour les
hématologistes. Il est indiqué devant des cytopénies, lors de bilan d'extension
de tumeurs, dans le diagnostic de certaines maladies infectieuses ou de fièvre
d'origine indéterminée, lors d'hyperprotidémie et d'hypercalcémie, et pour
évaluer la réserve médullaire en fer. Le myélogramme obtenu par cytoponction de
moelle osseuse est plus fréquemment effectué en hématologie car il suffit à
établir un diagnostic dans de nombreuses situations. Cependant, lors d'échecs
répétés, la biopsie peut s'avérer nécessaire, et son analyse nécessite
obligatoirement l'aide d'un anatomopathologiste. Pour une interprétation
correcte du myélogramme, certaines conditions doivent être remplies.
LE MYELOGRAMME
Le myélogramme est l'ensemble des éléments fournis par l'examen au microscope
d'un frottis de moelle osseuse hématopoïétique recueillie par
ponction-aspiration (fig 1). Il comprend l'appréciation de la richesse du
frottis en cellules nucléées (lignée mégacaryocytaire comprise), le pourcentage
de chacune des catégories de cellules et de leur morphologie. Il permet
également la mise en évidence de parasites, d'agents infectieux et de cellules
tumorales d'origine médullaire ou étrangères (métastases) [1].
Figure 1 :
ponction aspiration sternale à l'aide d'un trocart à usage unique
LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
- Indications
La décision d'évaluer la moelle osseuse doit être prise dans plusieurs
situations [2–3] :
• Lors d'affection à dominante hématologique primaire ou secondaire sans que
celle-ci ne puisse être explicitée par l'hémogramme;
• Lors de la mise en évidence de cellules inhabituelles (exp: mastocytes) ou de
morphologie anormale ou de blastes dans le sang (dysmyélopoïèse, leucémies,
forme leucémique de lymphome,...);
• Dans le cadre du bilan d'extension du lymphome malin;
• Lors de suspicion de maladies spécifiques telles que le myélome multiple,
l'histiocytose maligne ou la leishmaniose;
• Lors d'hyperprotidémie ou d'hypercalcémie inexpliquées;
• Lors de lésions osseuses radiotransparentes pouvant évoquer une lyse
tumorale.
- Contre-indications
Les contre-indications sont les troubles de l'hémostase, la pyodermite
bactérienne/abcès, l'irradiation sternale, et les antécédents de fracture
sternale.
MATERIEL ET TECHNIQUE DE PRELEVEMENT
- MATERIEL
Le classique trocart de Mallarmé est actuellement
supplanté par des trocarts à usage unique type aiguille (fig2, fig3) de 16 à 18
G de diamètre. Des seringues stériles de 20 ml sont nécessaires pour
l'aspiration (fig1).
Figure 2 :
trocarts à usage unique
- LIEU DE PRELEVEMENT
Le prélèvement de moelle osseuse hématopoïétique s'effectue au niveau du
sternum (au niveau du 1ère espace intercostal ou de l'épine iliaque postéro
supérieure) en position de décubitus dorsal.
Chez l.enfant :
- Soit épiphyse tibiale supérieure.
- Soit apophyse épineuse vertébrale supérieure.
- TECHNIQUE DE COLLECTION
La technique de prélèvement débute par le repérage de l'os avec l'index. Après
une désinfection cutanée soigneuse, l'opérateur traverse perpendiculairement
les plans cutanés puis l'os est recherché avec la pointe du trocart, après une
anesthésie locale (XylocaïneÒ ou EmlaÒ) (fig 3). Il convient de l'enfoncer fermement, mais
progressivement pour éviter de riper en taraudant (mouvement de «
vissage-dévissage »). En général, l'os se laisse facilement pénétrer, sauf en
cas de myélofibrose. Lorsque le trocart est solidement introduit dans l'os, le
mandrin est retiré et la seringue est mise en place. Une aspiration est
réalisée par dépressions brèves mais énergiques, jusqu'à apercevoir une goutte
de suc médullaire mêlée de sang (aspect de sang épais). Le patient décrit une
sensation d'« arrachement » lors de l'aspiration.
Figure 3 :
Anesthésié locale au niveau sternal avec de la xylocaïne
INCIDENTS ET ACCIDENTS
- En cas d'insuccès, le mandrin est remis en place et le trocart est enfoncé
davantage. Il est également possible de modifier le lieu de ponction. Souvent,
cet « échec » correspond à une moelle désertique, fibreuse ou envahie de
métastases. Les complications sont rares. En cas de thrombopénie ou
d'hyperviscosité sanguine, un saignement peut survenir, jugulable par simple
pression.
- Perforation sternale et plaie avec éventuellement atteinte des vaisseaux sous
jacents
ÉTALEMENT DE LA
MOELLE OSSEUSE
- MATERIEL
Le matériel nécessaire comprend plusieurs lames de verre lavées et dégraissées
(fig 4), une lamelle rodée pour étalement, un crayon marqueur. Tout le matériel
doit être préparé avant que l'aspiration médullaire ne soit effectuée et
laissée dans le voisinage de l'opérateur afin que les étalements soient
réalisés immédiatement après la ponction. Cette recommandation, capitale,
s'explique par le fait que le suc médullaire coagule dans les 30 secondes qui
suivent sa collection.
Figure 4 : Etapes
de confection du frottis de moelle osseuse
- CONFECTION DU FROTTIS
- Après avoir retiré le trocart de l'os, la seringue est démontée, un peu d'air
est aspiré. Puis la seringue est remise en place. Le contenu est déposé
délicatement sur les lames (une goutte par lame) par mouvement du piston
(fig4). Le produit recueilli est étalé avec la lamelle rodée comme un frottis
sanguin, ou selon les techniques d'étirement entre deux lames perpendiculaires
(goutte déposée à l'extrémité de l'une des lames) ou parallèles (goutte déposée
au centre) (Fig4).
- L'étalement est séché à l'air par agitation. Les lames sont identifiées. Un
prélèvement correct doit être fin (couche monocellulaire) et présenter de
petits amas grumeleux en queue de frottis qui correspondent aux grains de
moelle. Les frottis doivent être nombreux pour permettre, si nécessaire, la
réalisation de techniques cytochimiques ou immunocytochimiques dans le cadre
des leucémies ou des syndromes myélo- et lymphoprolifératifs. Il est possible
de colorer de façon rapide l'un des frottis pour apprécier la qualité du
prélèvement (richesse en cellules nucléées, en graisse et en grains de moelle,
évaluée à un grossissement ×100). En cas de forte dilution par du sang, il est
préférable de renouveler le prélèvement.
- Le biologiste effectue sur plusieurs lames de moelle une coloration au
May-Grünwald-Giemsa (coloration très nuancée des cellules mettant
particulièrement bien en évidence le caractère basique ou acide des cytoplasmes
et des granulations) et éventuellement des colorations cytochimiques sur les
autres.
EXAMEN DE L'ETALEMENT DE MOELLE OSSEUSE
Une évaluation précise d'un échantillon médullaire nécessite d'examiner les
frottis de manière systématique, méthodique et logique.
Technique de lecture
- La lecture d'un frottis médullaire consiste en une observation à faible
grossissement pour apprécier la cellularité globale puis ensuite en une lecture
à fort grossissement (objectif 100 à immersion) en queue de frottis afin
d'effectuer une formule et d'observer la morphologie des cellules. L'examen au
fort grossissement permet une analyse cytologique précise. Toutes les
modifications sont décrites, les éléments inhabituels sont notés.
- Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaître non seulement les cellules
médullaires normales, mais aussi les cellules néoplasiques qui ont la
propension à infiltrer la moelle osseuse, les organismes qui peuvent infecter
la moelle et enfin les processus (par exemple le syndrome d'activation
macrophagique) qui apparaît dans certaines conditions pathologiques.
CONCLUSION
- Le myélogramme est un examen complémentaire et indispensable en hématologie.
- Le respect de quelques recommandations simples, permettra l'amélioration de
sa pratique.
BIBLIOGRAPHIE
[1]. Sébahoun G, Horschowski N. Cytologie et histologie médullaires normales.
EMC (Elsevier SAS, Paris), Hématologie, 13-000-A-30, 2002: 8p.
[2]. Sebahoun G., Sainty D., Horschowski N. Ponction médullaire et biopsie
médullaire. Editions techniques. Encycl. Méd. Chir., (Paris, France),
Hématologie 13000, A30, 1991, 7p.
[3]. Hugard L., Abdou Souley A., Ndoye B., Saccharin C. Affections
hématologiques et myélogramme. Bilan de 5 ans à l'hôpital principal de Dakar
(Sénégal). Deuxième partie : le myélogramme est-il un examen justifié ? Méd. Afr. Noire, 1995 42, (12) : 605-665.